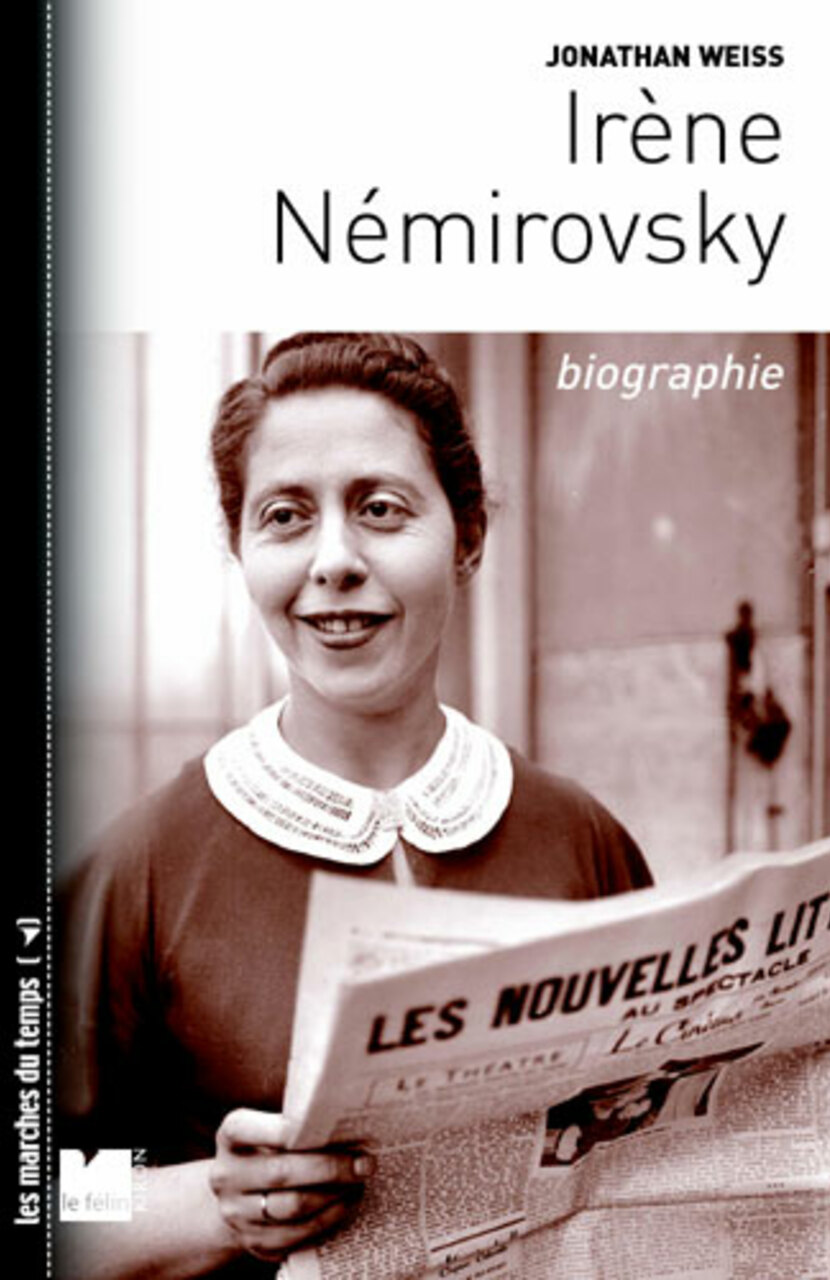
Irène Némirovsky
De Kiev à Paris
Pour comprendre Irène Némirovsky, il faut la saisir d’abord dans son rapport à ses origines. Ce n’est pas chose facile. Elle n’a laissé derrière elle aucun passeport ou autre document officiel d’avant son immigration en France. Peu loquace sur les origines russes et juives de sa famille, ce n’est qu’en 1930, après le succès de son troisième roman, qu’elle se livre au chroniqueur des Nouvelles littéraires, Frédéric Lefèvre, à qui elle accorde une entrevue où elle retrace le chemin qui l’a amenée de sa Russie natale jusqu’en France. De son enfance elle parle peu. Le biographe reste sur sa faim.
Pourtant nous pouvons reconstruire sinon l’enfance d’Irène Némirovsky, du moins son contexte et son décor. Car Irène n’a pas échappé aux influences qui ont formé la haute bourgeoisie juive, celle qui côtoyait, avant la Révolution russe, le gouvernement impérial. De telles influences expliquent en partie certaines de ses affinités linguistiques, culturelles et ethniques.
Nous pouvons aussi vérifier sur place – c’est-à-dire en Ukraine – les documents ayant trait à l’origine d’Irène Némirovsky. L’annuaire des habitants de Kiev de 19091 contient les noms de plusieurs Némirovsky, dont Léon, le père d’Irène, et Boris, son grand-père paternel. Boris Solomonovitch y est identifié comme un entrepreneur demeurant au numéro 9 de la rue Nikolaïveskaya2. Quand on se rend à Kiev, on s’aperçoit que le bâtiment qui porte ce numéro n’est autre que la maison Guinzbourg, villa somptueuse bâtie selon un style italien classique. Quant à Léon Borisovich, l’annuaire lui attribue comme adresse le 11 de la rue Pouchkine. Cette maison existe encore ; elle possède trois étages, un portail en arc orné d’un écusson et flanqué de deux lions. Spacieuse, confortable, riche même, comme la maison Guinzbourg elle se situe en haut de la ville, au-dessus des quartiers pauvres, dans une rue bordée de tilleuls. Irène Némirovsky est née à Kiev le 24 février 19033, et c’est dans cette maison qu’elle a été élevée.
Selon Irène, son père Léon était « un grand banquier russe ». Ses affaires l’appelaient souvent à Moscou, où il avait « un pied-à-terre, un logement qu’il sous-louait, tout meublé, à un officier de la garde qui se trouvait alors détaché à Londres4 ». Ce rapport avec un officier de la garde impériale est l’un des indices des privilèges dont jouissait la famille Némirovsky. Il y en a d’autres. Les Némirovsky obtinrent, en 1913, le droit de s’installer à Saint-Pétersbourg (plus tard Petrograd), ville qui, comme toutes les capitales de l’Empire, n’acceptait qu’un petit nombre de juifs (environ trois pour cent de la population au début du siècle). Des financiers juifs importants, tels que le banquier Guinzbourg ou le magnat de chemin de fer Polyakov, y côtoyaient des artistes juifs assimilés (et parfois convertis) comme le peintre Isaac Levitan ou le compositeur Anton Rubinstein5.
Dans un pays où la population voyageait difficilement, et où il fallait un passeport pour tout déplacement hors de la ville où l’on habitait, la famille Némirovsky bénéficiait du privilège de prendre ses vacances loin de Kiev. « Pendant mon enfance, raconte Irène, nous allions quelquefois au bord de la mer, en Crimée ; en ce temps-là il n’y avait pas de chemin de fer pour relier Simferopol et Jalta, notre Nice. Il y avait douze heures de voiture à chevaux et on couchait à Simferopol 6. » Les Némirovsky obtenaient des visas pour se rendre à l’étranger ; c’est ainsi qu’ils venaient régulièrement passer leurs vacances en France, le plus souvent sur la Côte d’Azur.
Les contradictions qui vont marquer la vie adulte d’Irène Némirovsky ont leur origine dans cette jeunesse. La situation privilégiée de sa famille rend problématiques les rapports entre les Némirovsky et l’importante population juive de Kiev. L’attachement de Léon au système économique de l’Empire russe va définir ses rapports avec les bolcheviks et déterminer le destin de la famille après la Révolution. Sur Irène, qui n’a que seize ans quand sa famille s’installe en France, cette situation laisse une empreinte indélébile, mais qui ne sera perceptible dans ses écrits que longtemps après son départ de Russie. D’une part, la position sociale dont jouissait sa famille et qui les rapprochait davantage de la haute société chrétienne que de la petite bourgeoisie commerçante juive aide à déterminer chez elle une admiration pour la religion orthodoxe assortie d’une certaine condescendance pour les traditions juives. En même temps, apparaît une prédilection pour la langue et la culture françaises, qui sera déterminante non seulement dans son choix d’un pays d’exil mais, plus profondément, dans ses choix d’écrivain.
Un judaïsme ambigu
Longtemps après avoir quitté la Russie, Irène brossait un portrait dantesque de sa ville natale : « La ville ukrainienne […] était, aux yeux des Juifs qui l’habitaient, formée de trois régions distinctes, comme on voit sur les tableaux anciens : les réprouvés en bas, pris entre les ténèbres et les flammes de l’enfer ; les mortels, au centre de la toile, éclairés par une lumière tranquille et pâle ; et, en haut, le séjour des élus7. » Le quartier d’en haut était celui de la famille d’Irène :
Au sommet des collines couronnées de tilleuls, on trouvait, entre les maisons des hauts fonctionnaires russes et celles des seigneurs polonais, quelques beaux hôtels qui appartenaient à de riches Israélites. Ils avaient choisi ce quartier à cause de l’air pur que l’on y respirait, mais surtout parce que, en Russie, au commencement de ce siècle, sous le règne de Nicolas II, les Juifs n’étaient tolérés que dans certaines cités, dans certains districts, dans certaines rues, et même, parfois, d’un seul côté d’une rue, tandis que l’autre leur était interdit 8.
Les « élus » que furent les Némirovsky vivaient dans le quartier qui leur était réservé mais qui côtoyait des communautés chrétiennes et les tenait à l’écart de la plupart des autres juifs de la ville. Les parents d’Irène étaient-ils des juifs pratiquants ? Rien ne permet de le croire9, même si, dans ses œuvres, Irène montre une certaine familiarité avec les us et coutumes de sa religion. Vivre en compagnie des Russes rendait difficile sinon impossible l’obéissance aux rites juifs ; d’ailleurs, cette bourgeoisie voulait se dissocier des juifs pauvres qui, eux, pratiquaient strictement. Ainsi, remarque Irène, « les traditions [juives] étaient vraiment trop compliquées, trop sauvages pour être suivies fidèlement ; on en prenait et on en laissait. On jeûnait un jour par an, et, pour Pâques10, on mangeait du pain sans levain que l’on mélangeait, d’ailleurs, dans son assiette avec le pain russe ordinaire, ce qui était un grand péché11 ».
Irène observait les juifs du podol, quartier en bas de la ville, au bord du fleuve Dniepr, caractérisé par des rues étroites, de petites boutiques, des maisons modestes12 ; elle jugeait cette communauté de petits commerçants étrangère à elle et, somme toute, répugnante. « Un peuple d’enfants qui se roulaient dans la boue, ne parlaient que le yiddish, portaient des chemises en guenilles et des casquettes énormes sur des cous frêles et de longues boucles noires13 », écrit-elle. Est-ce un sentiment de supériorité de classe qui lui fait dire que les enfants « naissaient dans le quartier juif comme pullule la vermine » et que leurs parents étaient « bavards, obséquieux14 » ? Il s’agit pour Irène, comme pour la plupart des juifs assimilés de Kiev15, de montrer sa différence et de se distinguer, par sa culture russe, de ceux qui refusaient d’adopter la culture, et même parfois la langue du pays où ils habitaient.
L’attitude d’Irène n’est pas seulement sociale ; pour elle, la culture juive est peu propice à la création littéraire. C’est ainsi que, pour devenir écrivain, elle devra se montrer la moins juive possible. Rien n’est plus révélateur de cette attitude qu’une longue nouvelle qu’Irène composa à vingt ans vers 1923, et qu’elle publia en 1928. Cette œuvre, à travers une parabole, résume l’angoisse de l’écrivain obligé, par sa naissance, de vivre dans un milieu hostile à la création littéraire.
L’Enfant génial16 est l’histoire d’un poète juif, Ismaël Baruch, né dans une « grande ville marine et marchande du sud de la Russie, au bord de la mer Noire », sans doute Odessa. Son père, « revendeur de vieux habits et de ferraille », s’habille de façon traditionnelle (caftan, babouches et mèches bouclées, peïss en yiddish). Sa mère s’est fait couper les cheveux le jour de son mariage et, selon les coutumes des juifs orthodoxes, porte une perruque noire, « qui lui donnait la vague apparence d’une négresse lavée par les neiges et les pluies du Nord ». Plutôt que de suivre le métier et les coutumes de ses parents, Ismaël passe son temps à composer et réciter des vers dans les tavernes du port. Un jour, il est « découvert » par un jeune homme et sa maîtresse qu’Ismaël prend pour un « barine » et une princesse ; en réalité, ce ne sont qu’un jeune poète bohémien et la veuve de l’ancien gouverneur de la ville. Ceux-ci proposent à Ismaël de venir habiter chez eux. C’est ainsi qu’Ismaël finit par devenir la source d’inspiration du « barine » et de sa « princesse » et que s’installent entre eux trois une sympathie et une affinité que les parents du jeune juif ne peuvent comprendre, même s’ils tirent un certain orgueil de la situation privilégiée de leur fils. Mais au sommet de sa gloire, Ismaël perd confiance et cesse d’écrire. Ne pouvant plus chanter la beauté de la « princesse », il doit retourner auprès des siens. Son père lui trouve une place chez un tailleur. Ismaël redevient ce qu’il aurait été s’il n’avait pas rencontré le « barine ». Mais l’âme de ce jeune poète continue de se tourmenter. Un soir il rencontre, par hasard, le « barine » et resurgit son désespoir de ne plus être poète. Désespéré, Ismaël Baruch finit par se donner la mort.
Le problème d’Ismaël n’est pas la persécution dont souffre son peuple en Russie. Au contraire, l’aristocratie, peu connue pour son indulgence envers les juifs, parraine sa poésie, tandis que les parents du poète et la communauté à laquelle il appartient l’empêchent de composer, préférant le maintenir dans leur boutique insalubre. Descendant, selon les mots d’Irène, « de la race appauvrie, étiolée par les livres et qui craint la lumière du soleil17 », Ismaël, revenu dans son milieu natal, ne trouve plus les forces nécessaires à l’inspiration. Il est frappé par « une paresse invincible… une sensation de vide… une espèce de fatigue pénible, d’écœurement… une sensation de vide presque physique18 ». Et sa famille, bien entendu, n’y comprend rien : « Ils étaient tous là penchés sur lui, autour de lui, accrochés à lui, comme des humains qui veulent ouvrir de force de leurs doigts sacrilèges une fleur19. » D’enfant poète, Ismaël redevient un enfant juif ordinaire : « Autrefois, il avait été un enfant prodige ; à présent il n’était plus qu’un garçon gauche et stupide comme les autres20. »
Si la famille d’Ismaël ne comprend pas la raison de son suicide, le « barine », lui, la comprend parfaitement, car il a, comme Ismaël, l’âme d’un poète. « La mort, seule, nous sauve », dit-il à Ismaël, qui lui répond : « On peut toujours mourir21. » La mort d’Ismaël marque donc le renouveau de ses liens avec l’aristocratie russe ainsi qu’une rupture avec le milieu juif. C’est ainsi que la princesse vient fleurir sa tombe au cimetière juif, geste refusé par la famille du défunt : « Ses parents […] trouvèrent sur la pierre un bouquet de roses encore toutes fraîches ; ils reconnurent là un hommage de la princesse. Ils le jetèrent loin d’eux : la loi des Juifs défend de donner des fleurs aux morts22. »
Œuvre de jeunesse, L’Enfant génial exprime mieux la révolte d’Irène contre son milieu qu’elle ne dépeint la société juive. Si Irène ignore la richesse littéraire et artistique des juifs d’Europe centrale, si elle passe sous silence la générosité de cette culture d’hommes craignant pour leur vie, c’est qu’elle ne voit que ce qu’elle perçoit du balcon de sa maison de la rue Pouchkine. En 1930, avec du recul, elle se rendit compte de son erreur et renia cette nouvelle. « Ne m’en parlez pas, dit-elle dans un entretien, je viens d’y jeter un coup d’œil, et j’ai refermé le livre bien vite. Je le trouve si mauvais23. »
Si Irène finit par désavouer la sévérité de son jugement dans L’Enfant génial, elle ne peut s’empêcher, dans son œuvre, de traiter les Russes et les Ukrainiens avec plus de sympathie que les juifs. Dans ce contexte, les rites de l’Église orthodoxe revêtent une importance au moins égale sinon supérieure aux rites juifs. Dans Le Vin de solitude, publié en 1935, elle brosse le portrait réconfortant d’une église orthodoxe où, entourée de « deux pauvres cierges allumés sous l’image de la Vierge », en écoutant « le doux crépitement des larmes de cire qui coulaient […] et tombaient sur les dalles, dans l’intervalle des répons », Hélène, la jeune juive protagoniste du roman, « ne redoutait rien […] se laissait bercer par un rêve apaisant ». Lorsque cette même jeune fille s’aventurait au podol, « dès qu’elle se trouvait dans la rue noire, dès qu’elle longeait le canal sombre et fétide, […] son cœur se serrait d’une mortelle angoisse24 ».
Sous la plume d’Irène, les Ukrainiens sont un peuple chaleureux, attirant, fascinant. Dans une nouvelle publiée en 1940, elle raconte l’aventure vécue par une jeune fille russe qui, sous le regard de sa gouvernante française, se lie d’amitié avec une famille ukrainienne qui vit à la campagne, non loin de Kiev. Comme par hasard, cette héroïne s’appelle Irène.
Celle-ci affirme, dès le début du récit, qu’il s’agit d’un « souvenir d’enfance ». En dehors de toute signification autobiographique, cette nouvelle25 confirme sa préférence pour la petite bourgeoisie ukrainienne face à « la racaille, les Juifs infréquentables26 ». Intitulée « Les sortilèges », elle brosse un monde de magie et d’amour défendu, celui d’une famille ukrainienne qui habite la banlieue de Kiev. Irène, âgée de huit ans, leur rend régulièrement visite, accompagnée de son institutrice française. Quel lien pouvait-il exister entre la famille modeste d’un militaire en retraite et celle, plus aisée, d’Irène ? L’auteur ne l’explique pas ; ce qui l’intéresse est l’attrait qu’avait pour la jeune fille un foyer où régnaient le désordre et la passion. Car si les juifs modestes du podol semblent lui répugner, ces Ukrainiens représentent à la fois la beauté physique et des sensations agréables. Irène est attirée par la mère de famille, « forte, blonde, fanée, moelleuse et blanche comme de la crème ». Et puis il y a le désordre sympathique d’une famille sans prétention (« on couche au salon, mais on mange dans la chambre à coucher et on fait sa toilette sur le perron ») et surtout son sens de la magie et du mystère. Les enfants courent en liberté sur l’herbe mouillée, sortent la nuit pendant l’orage, donnent libre cours à leurs instincts, par contraste avec la vie rangée et ordonnée qui est celle d’Irène dans sa famille. Habituée aux conversations portant sur l’argent et les affaires, elle est séduite par la maison des Ukrainiens, où l’on tire les cartes, et où, le soir, on joue à la magie et aux sortilèges. « Le désordre, le délabrement et la négligence » de cette demeure familiale, dit-elle, en font « l’habitation la plus chaude, la plus vivante qu’il m’ait été donné de voir27 ».
L’histoire d’un amour interdit, qui est au centre de la nouvelle (la mère aime en secret un médecin qui vient souvent à la maison et finit par séduire la fille aînée), nous importe peu. La tendresse avec laquelle Irène brosse un tableau de la famille ukrainienne et la sympathie qu’elle semble éprouver pour leurs coutumes païennes sont plus significatives. Le charme qu’exercent sur elle les sorts jetés par une amie de cette famille sera déterminant dans l’attitude de l’écrivain envers son pays natal.
La condescendance à l’égard des juifs du podol et la fascination naïve à l’égard des Ukrainiens la conduisent, pendant longtemps, à ne pas faire état des persécutions dont les juifs sont victimes dans l’Empire russe. Durant l’année 1905, deux pogromes ensanglantèrent Kiev ; le premier, perpétré par les autorités le 10 juillet, provoqua une centaine de morts, le second, en octobre, fit une quarantaine de victimes. C’est seulement à la fin des années trente qu’Irène, avec le recul et surtout face à la montée de l’antisémitisme dans les pays d’Europe centrale, réexamine ses convictions de jeunesse et fait, pour ainsi dire, amende honorable avec la publication de Les Chiens et les loups.
Les pogromes constituent la toile de fond de la première partie de ce roman situé dans une « ville ukrainienne » qui n’est autre que Kiev. « Il existait, écrit Irène, deux dangers qui ne ménageaient pas le reste de l’humanité, mais étaient dirigés plus spécialement contre les habitants de cette ville, de ce quartier… Ces deux dangers étaient les pogromes et le choléra28. » Aussi fait-elle vivre à la jeune protagoniste, Ada, un pogrome : « Toute la ville basse respirait peureusement, tapie derrière les doubles fenêtres, dans de petites pièces étroites, sombres et chaudes29. » Cachée, l’enfant survit à ces journées de destruction et de massacre.
Irène a-t-elle connu des enfants juifs qui auraient ainsi souffert ? Ni ses carnets ni ses œuvres littéraires ne laissent deviner de relations directes avec des juifs pauvres. Il est peu probable que la famille Némirovsky ait eu à souffrir des pogromes. L’importance des Chiens et les loups n’est donc pas dans son rapport avec la vie de l’auteur, mais dans le revirement de son attitude critique à l’égard des juifs de Kiev. Pour la première fois dans son œuvre, Irène reconnaît l’envers cruel de ce que vivent les populations russe et ukrainienne. Les « hymnes patriotiques » et les « prières de l’église russe » deviennent le bruit de fond du pogrome, et la « houle profonde et rythmée » ce sont les chants de la foule qui jette des pierres contre les magasins juifs, pille, massacre30.
Un amour de la France
« Depuis l’âge de quatre ans jusqu’à la guerre je suis venue à Paris tous les ans régulièrement. J’y avais séjourné la première fois pendant un an. J’ai été élevée par une institutrice française et avec ma mère j’ai toujours parlé français31. » Cette phrase résume la situation exceptionnelle que vécut Irène dans sa jeunesse. Elle vivait à Kiev comme on vit à Paris. Or il était d’usage dans la haute société russe de parler français et d’engager des gouvernantes étrangères, françaises ou anglaises, pour les enfants. Bien avant qu’elle ne s’établisse définitivement en France, le pays, sa langue et sa culture étaient familiers à la jeune Irène. La gouvernante française jouera d’ailleurs un rôle primordial dans sa vie. De l’origine et du destin de cette femme nous ne savons rien, mais Irène en dresse le portrait dans la nouvelle « Les sortilèges » qui, nous l’avons vu, a valeur autobiographique, et dans le roman Le Vin de solitude.
Appelée simplement « Mademoiselle » dans « Les sortilèges », la gouvernante accompagne Irène lors de ses visites à la famille ukrainienne. Elle la décrit « très droite dans son fauteuil, avec sa stricte robe noire, son petit col blanc et la chaîne d’or en sautoir sur sa mince poitrine ». Sa sobriété et surtout sa sagesse contrastent avec les débordements et les conjurations magiques de la famille ukrainienne qu’Irène fréquente. C’est cette gouvernante qui, à la fin de la nouvelle, lui montre que les sortilèges ne sont que « des bêtises » et que la passion, plutôt que la magie, est à l’origine du scandale qui a frappé la famille32.
Même si Le Vin de solitude n’est pas autobiographique, la description d’une gouvernante française nommée « Mademoiselle Rose » est, au dire d’Irène, « le portrait aussi fidèle que possible de mon ancienne institutrice33 ». Engagée par les parents d’Irène pour lui servir d’institutrice, son rôle semble avoir dépassé celui d’une enseignante pour devenir celui d’une amie et parfois d’un substitut à la mère. Irène prend soin d’indiquer que c’est Mlle Rose et non sa mère qui la borde la nuit, qui l’accompagne dehors, et qui, surtout, comprend ses inquiétudes d’adolescente.
Au-delà du rapport personnel entre la gouvernante et son élève, Irène brosse le portrait d’une beauté méridionale qui se fane au contact des pays du Nord :
Mlle Rose était fine et mince, avec une douce figure aux traits délicats, qui avait dû avoir dans sa jeunesse une certaine beauté, faite de grâce et de gaieté, mais qui était fripée maintenant, usée, maigrie ; la petite bouche était creusée du pli d’amertume et de souffrance qui marque les lèvres des femmes après trente ans ; elle avait de beaux yeux noirs et vifs de Méridionale, des cheveux châtains, crêpelés, légers comme une fumée, disposés, selon la mode de ce temps-là, en auréole aérienne autour d’un front lisse, dont la peau était douce et sentait le savon fin et l’essence de violette. Elle était paisible et sage, pleine de mesure et de raison ; pendant plusieurs années une gaieté innocente avait persisté en elle, malgré l’appréhension, la tristesse que lui inspiraient cette incohérente demeure, ce pays sans mesure…34
Par son apparence physique et son caractère, « Mademoiselle Rose » est à l’opposé du caractère slave : « Elle était ordonnée, exacte, méticuleuse, française jusqu’au bout des ongles, un peu sur son “quant-à-soi”, un peu moqueuse. Jamais de grands mots. […] Jamais de morale ; les recommandations les plus simples, les plus usuelles35. » Elle incarne la France dans l’imagination d’une jeune fille. Ainsi lui chante-t-elle des chansons patriotiques (« Vous avez pris l’Alsace et la Lorraine, mais malgré vous nous resterons français ») et des chansons d’amour (« Plaisir d’amour ne dure qu’un moment ») et dit que la France « est le plus beau pays du monde36… ».
C’est avec sa gouvernante qu’Irène retourne en France chaque année37 et tout permet de penser que c’est d’elle qu’Irène tient sa francophilie, son amour de la langue et de la culture françaises. Si Irène fait dire à Hélène, la jeune protagoniste russe du Vin de solitude : « Oh ! Comme je voudrais être française38 », et si elle lui fait regretter son retour en Russie, « un pays barbare où elle ne se sentait pas non plus tout à fait chez elle39 », c’est que la période russe de la vie de l’auteur est vécue sous le signe de la France, en compagnie de cette gouvernante devenue presque mythique aux yeux de la jeune fille.
Qu’est devenue cette gouvernante française ? Dans Le Vin de solitude, elle meurt pendant une nuit de révolte à Saint-Pétersbourg. Le portrait est-il fidèle à ce point ? C’est possible, mais dans une curieuse nouvelle publiée en 1938, « La confidence », nous voyons réapparaître une institutrice parisienne qui n’est pas sans rappeler « Mademoiselle Rose » bien que celle-ci s’appelle « Mademoiselle Blanche ». Ayant travaillé en Russie auprès d’une famille russe, elle garde de ce pays le souvenir délicieux d’une aventure amoureuse. S’agit-il de la même personne, qu’Irène aurait revue à Paris ? Quoi qu’il en soit, la gouvernante française ne s’est jamais effacée de l’imagination de l’auteur.
Si le français est la langue préférée de la famille Némirovsky, les lectures de jeunesse d’Irène sont européennes. Chez un officier de la Garde à Moscou, ami de son père, Irène déniche Huysmans et Maupassant, mais aussi Oscar Wilde et Platon. De ces auteurs, ce sont Huysmans et Wilde qu’elle lit avec la plus grande passion : « De Huysmans je lus À rebours. Je ne comprenais pas tout, mais ce livre me fut cependant une révélation. Il m’introduisait au cœur de la plus haute littérature française contemporaine ; presque toutes les préférences de Des Esseintes allaient être les miennes. Je vous avouerais même que j’essayais d’apprendre le latin pour replonger à mon tour dans ces auteurs de la décadence qui faisaient le délice du héros de Huysmans. C’est de cette époque aussi que date mon attachement à Oscar Wilde dont Le Portrait de Dorian Grey est le livre que je préfère40. » Cet enthousiasme est sans doute le fait d’une réaction contre la sobriété et la rigueur prônées par l’institutrice française, car l’esthétisme décadent de Huysmans ou de Wilde ne laisse pas d’empreinte sur l’œuvre à venir de la jeune Irène. En revanche, d’autres lectures vont avoir plus d’influence sur son art. Dans des notes insérées dans son carnet d’écrivain, elle cite, entre autres, Tourgueniev (dont elle a lu la biographie par André Maurois), James Cain (elle a écrit la préface à l’édition française du Facteur sonne deux fois) et Pearl Buck (elle a apprécié la simplicité stylistique de La Mère). Ces notes de lecture, qui datent des années trente, reflètent une sensibilité qui a mûri au contact de la culture française.
Irène a commencé d’écrire tôt. « Toute jeune, dit-elle, j’étais intriguée par tous ceux qui vivaient autour de moi, et j’ai commencé à écrivailler vers quinze ou seize ans, pour le plaisir de comprendre d’autres vies que la mienne, et, mieux encore, pour le plaisir d’en inventer41. » Mais elle détruit alors tout ce qu’elle écrit : « Ce n’était pas très original : des contes de fées, des poèmes en prose, imités de Wilde42. » Elle se met à tenir un carnet d’écrivain à l’âge de quinze ans ; dans un premier temps elle y recopie des citations et des adages d’auteurs pour la plupart français (Chamfort, La Rochefoucault). Ensuite elle y inscrira idées et projets de romans et de nouvelles. Ses premiers écrits datent de son arrivée en France en 1919 et ne concernent pas la Russie. Les images qu’elle a rapportées de ce pays, enfouies dans sa mémoire, n’en sortiront que plus tard : dans Les Mouches d’automne en 1931 et surtout Le Vin de solitude en 1935.
Quelle est l’importance de sa jeunesse russe dans l’œuvre littéraire d’Irène Némirovski ? «Je m’efforce de couler, dit-elle dans un entretien, dans une forme française, c’est-à-dire claire et ordonnée et aussi simple que possible, un fond qui est naturellement encore un peu slave43. » Il s’agit, pour reprendre l’expression de Jean-Jacques Bernard, de « pouvoir penser russe en français44 », de décrire pour un public français des images et des souvenirs russes. Cette explication est pourtant un peu trompeuse car, par contrairement à Henri Troyat venu de Russie en France la même année qu’elle, Irène ne se consacrera jamais à des cycles de romans sur la Russie et n’écrira qu’une seule biographie d’un auteur russe45. En fait, le fond slave ne constitue qu’une partie de son œuvre littéraire, moins importante que le versant français.
La fuite
La situation historique qu’Irène a vécue allait déterminer non seulement son installation définitive en France mais son attitude envers son pays d’adoption. En effet, contrairement à la grande majorité des juifs russes, à qui la Révolution soviétique offrait la lueur d’espoir d’une justice sociale, les Némirovsky faisaient partie de ces réfugiés « blancs » qui, fuyant le nouveau régime, s’établissaient en Europe de l’Ouest et surtout en France.
L’été 1918, la famille Némirovsky se trouvait à Saint-Pétersbourg. Selon le banquier Léon Némirovsky, cette ville, berceau de la Révolution, était en train de devenir hostile. Le tsar avait abdiqué et le gouvernement provisoire, sous la direction de Kerenski, ne parvenait pas à maîtriser la situation. Le retour de Lénine de son exil suisse et les manifestations ouvrières de juillet 1918 rendaient la situation critique. Léon décida d’installer provisoirement sa famille à Moscou. « Mon père, que ses affaires appelaient souvent à Moscou, avait là-bas un pied-à-terre, un logement qu’il sous-louait, tout meublé, à un officier de la Garde qui se trouvait alors détaché à Londres, à l’ambassade sans doute. Croyant que nous y serions plus tranquilles, mon père nous y emmena », raconte Irène46. Pour cette fillette de treize ans, ce refuge devient un château enchanté. « Il y a à Moscou de vieilles maisons qui sont en quelque sorte emboîtées les unes dans les autres. C’est ainsi que nous habitions la maison la plus intérieure, ce qui serait le donjon dans un vieux château français. Elle était entourée d’une cour où je m’échappais [afin de] ramasser des douilles de cartouches quand on ne me voyait pas47. » Peu consciente de ce qui se passait à l’extérieur, Irène piochait dans la bibliothèque de l’officier : « C’est à Moscou que la Révolution se déchaîna avec le plus de violence. Le bombardement fut si terrible que des soldats ayant fait la guerre ont affirmé que c’était plus effrayant qu’au front. Heureusement, pour la fillette que j’étais, l’officier de la Garde était un lettré. […] Pelotonnée sur un divan, j’étais très fière de lire Le Banquet pendant que la fusillade faisait rage. Ma mère était outrée de mon indifférence, et chaque fois qu’elle passait devant moi, me faisait des remontrances48. » La situation à Moscou devenant intenable, Léon préféra ramener sa famille à Petrograd. Mais dans cette ville, en octobre 1918, n’était guère moins dangereuse pour le banquier.
Le 7 novembre les ouvriers prirent le palais d’Hiver et un gouvernement bolchevique fut installé. Tout espoir d’un gouvernement libéral étant exclu, Léon Némirovsky fut obligé de se cacher. C’est alors que la famille prit le chemin emprunté par nombre de Russes antirévolutionnaires, celui de la Finlande. « Nous nous sauvâmes en Finlande, déguisés en paysans. C’était en décembre 1918. Nous y sommes restés un an, dans un village de deux ou trois feux, espérant toujours pouvoir rentrer à la maison49. »
Le séjour en Finlande laissa son empreinte sur Irène car, loin d’être le refuge paisible que sa famille attendait, ce pays était lui aussi en pleine guerre civile. Gardes rouges et forces conservatrices, sous la direction du général Mannerheim, se disputaient la partie sud du pays. Cette guerre lui inspira deux nouvelles dont l’une, intitulée « Aïno » (publiée en 1940), se présente d’emblée comme un souvenir autobiographique : « J’avais quinze ans. J’étais une enfant d’émigrés russes. J’habitais en Finlande, dans un hameau perdu au fond des forêts […] c’était l’hiver et la guerre civile50. » Quoique Irène ne précise jamais le nom du lieu où habitait sa famille, il s’agit certainement – les descriptions le confirment – d’un village près de Terijoki qu’en avril 1918 les troupes conservatrices (blanches) du général Mannerheim disputaient aux gardes rouges. Ainsi les Némirovsky, tout antibolcheviques qu’ils étaient, avaient-ils trouvé refuge « parmi ces bûcherons et ces chasseurs bolcheviques51 » qui occupaient le village depuis décembre 1917.
Les Némirovsky n’y souffraient pas de privations. Avec d’autres familles de réfugiés, ils habitaient l’hôtel et se faisaient servir par des paysans finlandais : « Les filles, les femmes de ces paysans servaient chez nous, dans l’hôtel où nous étions réfugiés. Imaginez une maison à un étage, avec de petites fenêtres, de grands couloirs glacés, des murs de bois frais encore odorants et collants de résine. Tout autour il y avait, dans la saison d’été, un jardin, des sentiers et une pelouse52. » Le séjour finlandais ressemble plus à une cure qu’à un exil : « On respirait la santé et le bonheur par ces matins étincelants, quand on courait à travers les forêts, quand on conduisait les légers et rapides traîneaux53. » Pendant que les adultes jouaient au whist, les enfants s’amusaient dans la neige. Pour la jeune Irène les seuls inconvénients étaient une garde-robe réduite (« Nous avions fui la Russie si vite que j’avais pour tout bien un peu de linge et deux robes54 ») et le manque d’électricité (« Nous n’avions pas d’électricité ; le pétrole était rare55 »).
Sans grand-chose à faire et sans amis dans le cercle des réfugiés russes (« À l’hôtel habitaient des grandes personnes, de tout jeunes enfants et un petit groupe de garçons et de filles de vingt à vingt-deux ans qui me dédaignaient56 »), Irène découvre en compagnie d’une jeune Finlandaise une maison abandonnée qui cache une bibliothèque bien fournie en livres français et anglais : « J’étais amoureuse des livres. Je ne regardais qu’eux d’abord, livres français, anglais, russes. Je restais là, immobile, m’abîmant les yeux dans cette froide et blanche lumière que répandait la neige. Les livres étaient singuliers, féeriques ; Maeterlinck, Oscar Wilde, Henri de Régnier57… » Au fond, son séjour finlandais lui paraît féerique.
La guerre, pourtant proche, semble loin : « On se battait à quelques lieues de notre village… Dans la forêt brillaient des feux. Les servantes aux paupières baissées continuaient à préparer les repas et à les servir […] et personne, certes, n’eût pu deviner que le sort de leurs maris, de leurs frères, de leurs fils se jouait là58. » Irène refuse de faire une analyse politique de son expérience finlandaise, seul compte pour elle le drame humain. Elle avait déjà mis en scène la Finlande dans une nouvelle publiée en 1934, « Les fumées du vin » : « Il y a quinze ans de cela les pays voisins s’agitaient et la tranquille Finlande avait pris feu à son tour », écrit-elle au début de la nouvelle59, mais le feu qui l’intéresse est celui des passions. La stricte morale protestante des Finlandais est déstabilisée par la guerre ; la garde rouge se livre à un déchaînement de passions et d’ivresse, les caves sont vidées en même temps que les ennemis tués : « L’orgie s’est terminée dans le sang60. » Même pendant la guerre, la Finlande – la neige, le brouillard, les ombres furtives qui courent dans le village – demeure pour Irène « le pays le plus mystérieux du monde61 ».
Avec la fin de la guerre civile finlandaise, en mai 1918, le pays passa sous le contrôle des blancs et le général Mannerheim fut nommé régent. En Russie, la situation n’était guère favorable à un retour de la famille Némirovsky. Lénine avait consolidé son pouvoir à Moscou et Saint-Pétersbourg, et l’intervention des forces alliées en faveur des contre-révolutionnaires ne parvenait pas à déstabiliser le régime bolchevique. Aussi Léon décida-t-il d’aller vers l’ouest, afin de trouver le moyen d’immigrer en France. « Quand nous avons vu que la situation ne faisait qu’empirer, nous avons gagné Stockholm où nous sommes restés trois mois. C’est une ville délicieuse, dont j’ai gardé un excellent souvenir62. » Ce souvenir n’inspira pourtant aucun texte littéraire ; la Suède n’était qu’une étape dans la poursuite de l’objectif final.
« Quand nous avons quitté Stockholm, nous sommes venus en France sur un petit cargo, dix jours sans escale avec une effroyable tempête63. » C’est au printemps de 1919 qu’Irène arriva en France avec sa famille. Comme beaucoup d’autres Russes blancs Léon Némirovsky ne fuyait pas la misère mais un régime qui n’était pas compatible avec sa profession. Il s’agissait à la fois d’un choix politique et d’une nécessité économique.
La venue en France apparaîtra à Irène, plus tard, comme la réalisation d’un rêve. C’est le sens qu’il faut donner à la description, dans Le Vin de solitude, écrit quinze ans plus tard, de l’émotion d’une jeune Russe qui, comme l’auteur, arrive sur un paquebot au printemps 1919 :
Hélène alla se cacher à sa place préférée, à l’avant du bateau… Longtemps, elle regarda les rives de la France qui flottaient doucement au-devant d’elle dans la nuit. Elle les contemplait avec tendresse. Jamais, en revoyant la Russie, son cœur n’avait battu si joyeusement… À mesure qu’elle approchait, il lui semblait reconnaître l’odeur du vent ; elle ferma les yeux… La mer scintillait faiblement éclairée par les feux du navire. Doucement elle tendit les lèvres, comme si elle eût voulu baiser au vol l’air marin. Elle se sentait légère et soulevée de joie, comme portée en avant par une force plus puissante qu’elle-même64.
La liberté que la France offre à Irène est toute personnelle ; il s’agit de la liberté de pouvoir écrire dans la langue qu’elle préfère et d’être publiée. Ainsi dès son arrivée commence-t-elle à écrire en français : « J’avais envoyé des dialogues comiques à Fantasio qui les avait publiés65. » Fantasio, dont le premier numéro date de 1906, était une revue mensuelle qui contenait des dessins lestes de « petites femmes » dénudées, des dessins comiques à caractère grivois et des nouvelles et dialogues légers, le tout destiné aux « messieurs ». Pour Irène, peu importait le caractère de la revue ; il s’agissait surtout de se faire publier en France. « Vous pensez si j’étais fière ! » s’exclame-t-elle dans un entretien66.
Il y a une certaine naïveté dans l’attitude de la jeune fille envers son pays d’adoption. La politique ne l’intéresse que peu, même lorsque éclatent des scandales mettant en accusation des ressortissants étrangers, l’affaire Stavisky par exemple. Jusqu’à ce que l’occupation allemande la contraigne à s’exiler de Paris, et même au-delà, elle conservera une foi absolue dans l’accueil de la France. Qu’on ne s’étonne donc pas de trouver dans ses écrits cette évocation de l’Arc de triomphe par la jeune héroïne du Vin de solitude :
Hélène écoutait le vent ; elle tendait l’oreille comme à la voix d’un ami. Il naissait sous l’Arc de triomphe, il courait d’abord sur les cimes des arbres qui s’inclinaient, puis il entourait Hélène, sifflait et bondissait joyeusement […] Le vent séchait les larmes d’Hélène, brûlait ses yeux […] « Je n’ai pas peur de la vie », songea-t-elle. […] Elle se leva, et, à ce moment, les nuages s’écartaient ; entre les piliers de l’Arc de triomphe le ciel bleu parut et éclaira son chemin67.
Si l’on peut assimiler la situation de la famille Némirovsky à celle des autres rescapés du régime bolchevique, on doit distinguer chez Irène la volonté de s’intégrer à son pays d’adoption. Il ne s’agira pas pour elle de vivre à côté des Français mais de vivre avec eux, comme eux. C’est ainsi que, tout en ne rompant pas avec les cercles de réfugiés russes, Irène préférera des amitiés françaises.
Couronnée à titre posthume par le prix Renaudot 2004 pour Suite française, Irène Némirovsky, un des grands auteurs de l’entre-deux guerres, sort aujourd’hui de l’ombre. A partir d’entretiens, d’analyses et de correspondances inédites, cette biographie passionnante retrace un destin et une œuvre uniques, sous l’angle de la relation complexe entre l’écrivain et son identité culturelle. Fille de riches banquiers, Irène Némirovsky, qui a quitté Kiev pour Paris au lendemain de la Révolution bolchevique, connaît à 26 ans une gloire fulgurante avec son roman David Golder. Cette dénonciation parfois caricaturale du milieu juif des affaires lui vaut de nombreuses amitiés dans la droite antisémite sans pour autant lui permettre de s’intégrer à la bourgeoisie parisienne. Elle reste « l’amie juive », car elle brocarde cruellement sa propre communauté. Mais, confrontée à la montée de l’antisémitisme, elle récuse un discours auquel elle avait pu paraître s’associer. Après s’être vu refuser la nationalité française, elle est déportée à Auschwitz où elle meurt en 1942.
Jonathan Weiss, professeur de littérature à Colby College aux États-Unis, analyse ce décalage entre l’identité réelle et l’identité « rêvée » d’Irène Némirovsky et explore une œuvre qui revisite comme aucune autre l’histoire juive, les tourments de l’exil, l’abandon des non-juifs et la solidarité d’un peuple persécuté.
"Face à un tel destin artistique et humain, à la fois unique et emblématique de la confiance de bien des juifs dans une france qui les a pourtant livrés à la mort, la biographie de Jonathan Weiss inspire de véritables réserves. L'universitaire américain aborde en effet l'oeuvre d'Irène Némirovsky sous le prisme d'un anti-judaïsme forcément polémique. C'est là mal comprendre l'oeuvre d'Irène Némirovsky; certes, et notamment dans "David Golder", elle n'épargne pas ses coreligionnaires. Mais elle fait de même avec toute la société. Et c'est précisément pour ce regard implacable mais plein d'empathie et pour la finesse d'écriture que l'oeuvre de Némirovsky est à lire et à relire." Madama Figaro, 16 Avril 2005