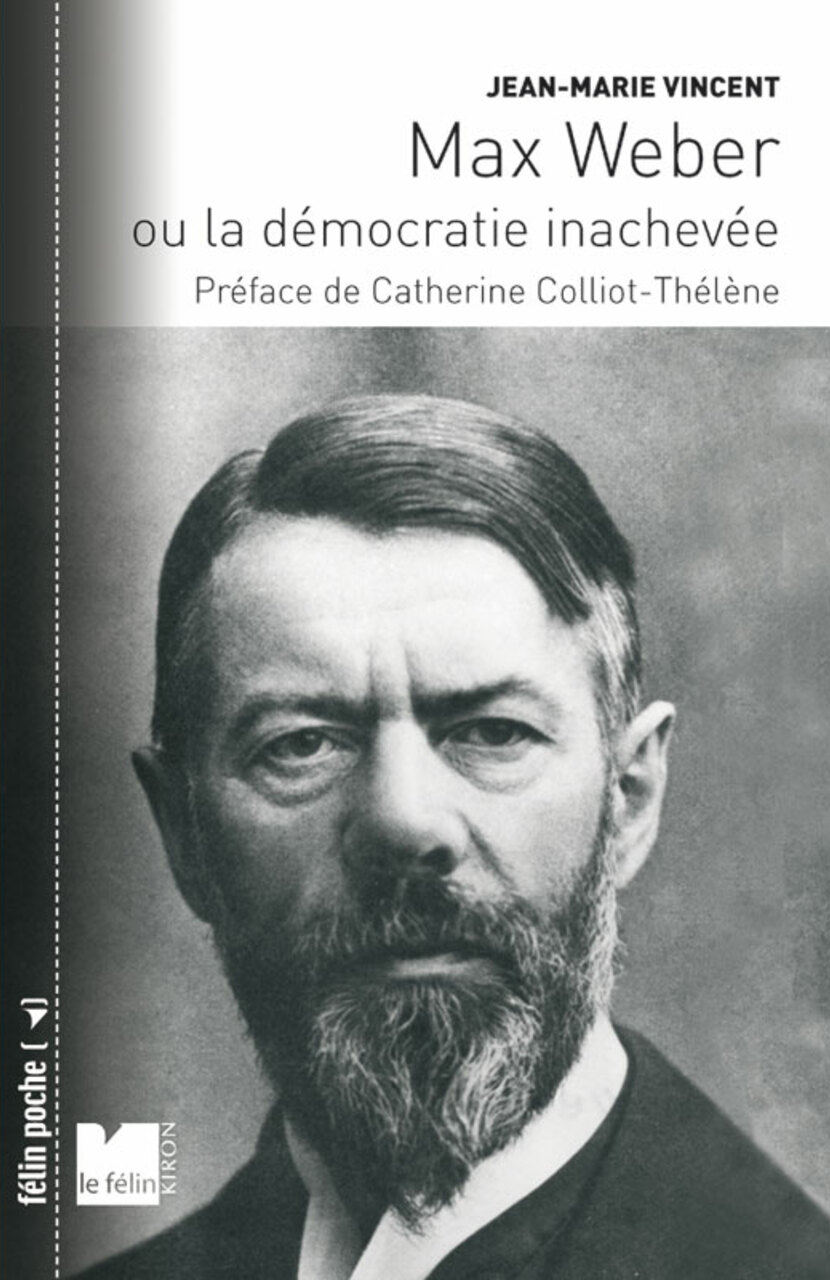
Max Weber ou la démocratie inachevée
21 avril 1864. Naissance de Max Weber à Erfurt.
1882. Max Weber commence des études de droit à l’université de Heidelberg.
1884-1885. Études à Berlin. Droit, économie, histoire.
1888. Membre du Verein für Sozialpolitik.
1889. Doctorat sur les sociétés commerciales au Moyen Âge.
1891. Étude sur l’histoire agraire romaine.
1892. Travail sur les ouvriers agricoles à l’est de l’Elbe.
1893. Max Weber est proposé comme professeur d’économie à l’université de Fribourg. Épouse Marianne Schnitger.
Mai 1895. Leçon inaugurale à Fribourg.
1895. Est nommé à l’université de Heidelberg.
1897. Débats acerbes avec son père.
1899. Premières atteintes d’une maladie dépressive. Max Weber quitte l’Université.
1900-1902. Max Weber voyage.
1903. Professeur honoraire.
1904. Voyage aux États-Unis. Participe à la direction de la revue Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
1905. L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme.
1908. Max Weber s’oppose à la discrimination contre les sociaux-démocrates dans les universités.
1909. Les rapports agraires dans l’Antiquité.
1910. Prend part aux délibérations du Verein für Sozialpolitik.
1911. Prend part aux débats de la Société allemande de sociologie.
1916. Mémorandum contre la guerre sous-marine, écrit L’Éthique économique des grandes religions.
1917. Nombreuses publications dans la presse sur la parlementarisation nécessaire de l’Allemagne.
1918. Leçons à l’université de Vienne. Participe, après l’éclatement de la révolution de novembre 1918, au Parti démocratique allemand.
1919. Suit les pourparlers de paix entre l’Allemagne et les Alliés. Enseigne à l’université de Munich.
Juin 1920. Mort de Max Weber à la suite d’une pneumonie.
Introduction
Les pages que l’on va lire ne sont pas une lecture désintéressée de l’œuvre de Weber. Elles obéissent à une lecture singulière, une stratégie de questionnement destinée à faire «parler» des textes souvent recouverts par des commentaires ou des interprétations devenues trop évidentes.
Max Weber est un classique de la sociologie, mais il ne l’a pas toujours été et l’on oublie souvent que ses préoccupations n’étaient pas à proprement parler académiques. Il voulait déranger, bousculer des habitudes, remettre en question des pratiques routinières. À bien des égards, il était un non-conformiste qui cherchait à ébranler les certitudes des courants intellectuels dominants de son temps. De façon caractéristique, il était un critique très sévère de l’Université allemande en raison de sa soumission au pouvoir impérial. Il reprochait avec véhémence à ses collègues d’écarter de l’Université les esprits les plus critiques et les plus aigus. Il a ainsi vainement mené bataille en faveur de Georg Simmel, victime d’un antisémitisme qui n’osait pas toujours s’avouer, ou de Robert Michels, discriminé en tant que social-démocrate. Il s’opposait aux féodalités universitaires où le conformisme comptait plus que les capacités intellectuelles, et aux universitaires gérant leurs carrières comme des hommes d’affaires (cf. Thomas Burger, in Wagner Zipprian, 1994, p. 29, 104). Il est vrai qu’en même temps il se nourrissait à certains courants de la culture universitaire, par exemple au néokantisme de Rickert, mais il le faisait sans abandonner son acuité critique, et cela ne diminuait en rien son hostilité à la médiocrité de la majeure partie de la production des universités.
Weber était un marginal, mais il ne s’est jamais satisfait de cette marginalité qu’il s’est bien gardé d’aménager confortablement. Dans le « Verein für Sozialpolitik », l’association fondée par les socialistes de la chaire, il a mené une bataille constante contre les partisans de politiques sociales autoritaires, dont la pointe était tournée contre les syndicats et les organisations de salariés. Il a combattu en même temps les vues de ceux qui voulaient limiter et encadrer les initiatives entrepreneuriales au niveau économique. C’est aussi dans ce contexte qu’il faut situer la fameuse querelle sur la « neutralité axiologique » dans les sciences sociales (cf. Hennis, in Wagner Zipprian, p. 105-145) et historiques. Weber entendait bien forcer ses adversaires à argumenter sérieusement et notamment les obliger à renoncer à faire appel à des normes morales et politiques dans les affrontements théoriques. Le travail de chercheur, de ce point de vue, devait se manifester comme une véritable ascèse intellectuelle, une ascèse d’un type, il est vrai, assez particulier, puisqu’elle devait être faite non seulement de renoncements au normatif et aux jugements de valeur déguisés, mais aussi de questions nouvelles et de déplacements d’horizons secouant les quiétudes théoriques. C’est d’ailleurs dans cet esprit que Weber a noué des alliances et des amitiés intellectuelles avec une très grande absence de préjugés. À l’Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik il a collaboré avec Werner Sombart, lui aussi marginal dans le monde universitaire, et il en a ouvert les colonnes à Robert Michels et à bien d’autres têtes critiques refusées par l’Université. Le salon qu’il tenait à Heidelberg réunissait des intellectuels très divers du point de vue de leurs origines et de leurs centres d’intérêt. On pouvait y rencontrer aussi bien Georg Lukács, que Weber estimait beaucoup, et Ernst Bloch qu’il estimait moins à cause de son extrémisme. Weber était en fait plein de curiosité et pensait que des théories aventurées, une fois passées au crible de la critique, pouvaient ouvrir de nouveaux horizons à la recherche en sciences sociales.
Sa volonté de faire prévaloir la neutralité axiologique en sociologie et en histoire n’avait donc rien à voir avec une quelconque tentation de neutralité académique ou d’autolimitation. Il voulait faire des sciences sociales des disciplines de combat, susceptibles d’éclairer les grands problèmes de la période, sans recourir pour autant à des conceptions trop facilement totalisantes. L’objet de la sociologie ne pouvait être la totalité de la société, mais bien un certain nombre de relations sociales, découpées et cadrées en fonction des intérêts et des points de vue des chercheurs, en fonction aussi de leur insertion dans des champs culturels et sociaux concrets. Pour lui, la sociologie était, en ce sens, intervention dans des contextes tout à fait situés, intervention d’autant plus efficace qu’elle était à même d’utiliser des procédures rigoureuses pour limiter les effets de la subjectivité du sociologue. Weber ne croyait absolument pas que l’on puisse produire des connaissances pures et intemporelles, mais il était persuadé qu’on pouvait obtenir des connaissances contextualisées constituant autant d’instruments de travail intellectuel sur le social. Le sociologue ne devait surtout rien prescrire en tant que sociologue, il lui incombait en revanche de mettre en lumière des enchaînements, des liaisons entre les phénomènes pour éclairer les décisions à prendre dans l’action. Le travail sociologique était par suite un travail en permanence sous tension, entre un engagement intellectuel fort et la recherche de l’objectivité procédurale, entre l’investissement subjectif et la prise de distance par rapport à cet investissement; enfin entre l’ambition des visées (l’explication au-delà de l’interprétation) et la modestie des résultats obtenus (le plus souvent des réfutations de vues erronées).
Cela ne voulait toutefois pas dire que Weber ait renoncé à penser son époque, donc à la conceptualiser et à la faire entrer dans un cadre théorique. Il récusait toute construction « émanatiste», c’est-à-dire tout ce qui aurait pu ressembler à un système déductif, mais il estimait possible de saisir certains traits essentiels de la dynamique sociale en formulant des problématiques en rupture ou en déséquilibre avec les théorisations jusqu’alors admises. Il avait parfaitement conscience du caractère forcément unilatéral de toute problématique et acceptait en conséquence que les siennes pussent être remises en question. Comme il l’a montré dans les réponses aux critiques faites à l’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme, il ne refusait ni de rectifier ni de préciser certaines de ses analyses. En revanche, il se montrait intraitable lorsqu’il avait l’impression que ses critiques n’avaient pas de problématiques plus fortes à lui opposer ou ne comprenaient pas la portée de ses interrogations et inquiétudes théoriques (Protestantische Ethik, II).
Dans les débats qu’il a eu avec ses prédécesseurs et ses contemporains, l’analyse du capitalisme a évidemment joué un très grand rôle, mais ses préoccupations les plus fondamentales allaient beaucoup plus loin. En cherchant le fil conducteur qui relie les textes sur le capitalisme, sur la sociologie de la religion, l’histoire économique, on peut s’apercevoir qu’elles sont traversées par un questionnement récurrent sur la rationalité comme guide des activités humaines et comme composante essentielle de la culture. Pour Weber, la rationalité n’était ni la Raison emphatique de la philosophie classique allemande (Vernunft), ni le simple déploiement de l’intelligence dans des relations instrumentales au monde et à la société, mais bien une puissance organisatrice de la vie et de la culture (au même titre que la religion). Elle était, selon lui, «logos», c’est-à-dire façon théorique de considérer le monde et de prendre ses distances par rapport à lui; en même temps, elle recelait une dimension éthique qui s’exprimait dans une façon de se mesurer avec le monde pour s’imposer à lui. Pour reprendre des termes utilisés par Dolf Sternberger, la rationalité wébérienne relevait d’un «subjectivisme poïétique» (cité par Hommerich, 1986), d’un faire démiurgique qui ne pouvait renoncer à se faire violence et à faire violence aux autres. La rationalité, plus particulièrement la rationalité en finalité, avait en conséquence quelque chose à voir avec la domination, conçue, elle, de façon acritique par Weber comme une sorte de quasi-donné anthropologique.
Il n’était certainement pas un adorateur de la violence, même si on lui doit des éloges appuyés de l’État fort et militarisé. Dans son esprit, la rationalité était surtout culture, manifestation de l’homme de culture innovateur (Kulturmensch) qui pouvait être aussi bien l’entrepreneur que le chef politique ou le grand artiste. Il était, toutefois, obligé de constater lui-même que les hommes de culture des débuts du capitalisme étaient de plus en plus remplacés par des gestionnaires, des administrateurs et des artistes sans imagination. Il imputait ces développements à des tendances à la «chosification» (Versachlichung) des activités et des relations humaines résultant des progrès scientifiques, technologiques et économiques sans se poser très explicitement la question des rapports de domination présents dans la dynamique sociale. Certes, il renvoyait aussi à la bureaucratisation et à la prolifération des institutions étatiques, mais il ne s’interrogeait pas outre mesure sur les dispositifs de domination impersonnels inscrits dans les rapports de travail ou dans les rapports de marché, et constituant autant de moyens de captation «quasi objective» des activités humaines. Il avait ainsi du mal à voir l’ubiquité des formes de violence «objective» dans les relations sociales et à mesurer leurs effets sur les possibilités d’affirmation de soi des individus. C’est sans doute cela qui explique ses variations et hésitations quant à l’avenir possible de la société capitaliste et quant à l’avenir de la liberté dans son sein. À certains moments, il annonçait un avenir de servitude, à d’autres il laissait entrevoir la possibilité faible de faire fond sur le charisme pour changer le cours des choses.
À partir de ses propres prémisses théoriques, il ne fallait évidemment pas demander à Weber de découvrir facilement du sens à l’histoire. On pourrait peut-être s’étonner qu’il n’ait pas envisagé au début du siècle une évolution possible vers moins de domination et de violence. Mais il est bien clair que la liberté ne pouvait, pour lui, être totalement déconnectée de la domination. L’homme de culture s’affirme libre, crée sa liberté en imposant sa volonté à d’autres et à lui-même. Il est en outre pris dans le piège du polythéisme des valeurs: il lui faut se décider pour des valeurs et les défendre de façon inconditionnelle, alors qu’il n’a pas d’autres critères à faire valoir que ses préférences personnelles. Il participe donc à un «combat des dieux» tout à fait paradoxal puisqu’il a lieu autour de valeurs problématiques (malgré tous les engagements qu’on prend en leur faveur) et qu’il produit difficilement du sens dans des affrontements souvent obscurs et dans un contexte dominé par des valeurs utilitaires. L’homme de culture, même s’il se conforme à une éthique de la responsabilité, ne peut prévoir et mesurer les effets de ses propres décisions. En particulier, il ne peut savoir s’il trouvera de l’écho parmi ceux à qui il s’adresse pour secouer de vieilles routines, ce qui signifie qu’il lui faut en fait s’en remettre au «destin» (Schicksal) comme une sorte de juge appelé à trancher dans le «combat des dieux».
L’homme de culture doit être prêt à supporter l’isolement et l’adversité, en sachant qu’il n’a jamais la certitude de pouvoir mettre beaucoup d’hommes de son côté et que l’échec peut être au bout du chemin.
Dans la position de Weber, il y a, en réalité, un présupposé sous-jacent: la création de nouvelles valeurs ne peut véritablement et directement concerner les grandes masses. En d’autres termes, ces dernières ne participent et ne peuvent participer à des processus de création de valeurs que par l’intermédiaire d’innovateurs charismatiques qui représentent une élite peu nombreuse. À proprement parler, il n’y a donc pas de processus collectifs de transformation ou de création de valeurs selon la théorisation wébérienne. Alfred Schütz, qui a suivi Weber sur bien des points, a bien senti qu’il y avait là un élément très discutable et dans Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt – Schütz, 1974 –, il lui oppose une conception des processus sociaux de production du sens à partir de schémas d’interprétation de la réalité dans le cadre des formes de vie sociale (Lebensformen) et de champs de significations déjà constitués. Dans la perspective de Schütz, les échanges interindividuels et sociaux de significations sont complexes, permanents, et entraînent des modifications dans les relations avec le monde social. Dans l’action, le sens visé dont parle Weber (der gemeinte Sinn) est polythétique, tout en constituant déjà un ensemble de significations (Sinnzusammenhang) qui doit se confronter à d’autres ensembles de significations. L’inventeur de sens ou de valeur n’agit pas sans arrière-plan social, ni sans échanges avec son environnement (Mitwelt). Le charisme dont il peut se prévaloir s’alimente en fait à beaucoup de sources, et dépend de nombreux processus entrelacés. La réceptivité dont il peut bénéficier ne peut d’ailleurs être assimilée à de la passivité, elle présuppose au contraire un terrain social balisé et des acteurs qui réagissent. Il y a, certes, dans le monde actuel, beaucoup d’obstacles aux échanges de sens; il y a notamment des rigidités quasi structurelles qui brident les actions de beaucoup trop d’acteurs et les empêchent d’avoir des initiatives dans ce domaine. Mais Weber, lorsqu’il traite de l’action (individuelle ou sociale), se place significativement dans le contexte de rapports de domination, sous-estime les possibilités de création de sens par en bas quand les rapports de pouvoir sont dans une phase de mutation.
Il n’est donc pas étonnant que ses vues sur la modernité aient été très contradictoires. D’un côté, il a été un chantre convaincu de tout ce qui est moderne, particulièrement de l’individualité; d’un autre côté, il s’est peu à peu persuadé que l’individu, isolé au milieu même de ses connexions au monde, ballotté au sein des relations sociales, n’était pas vraiment au centre des processus sociaux. Il n’a même pas écarté l’hypothèse d’une individualité en perdition dans un monde de plus en plus opaque (la thématique de la «nuit polaire»). Il a exalté la puissance de l’homme moderne, son style de vie, la richesse de son cosmos, sa capacité à se dépasser sans cesse; en même temps, il s’est demandé si cet homme n’était pas voué progressivement à l’impuissance, si sa culture pouvait être à la hauteur des défis de l’époque. En effet, il constatait une distance de plus en plus grande entre les processus objectifs et la subjectivité des individus, entre la pesanteur des dispositifs bureaucratiques et institutionnels et la capacité d’action des individus et des groupes sociaux. La modernité ne pouvait pas ne pas être antinomique et tragique, c’est-à-dire traversée par des crises, des bouleversements incessants, dans lesquels il ne pouvait qu’être très difficile de trouver des issues positives. La politique, en particulier, devait être placée sous le signe d’un double désenchantement, celui causé par le retrait du sacré et du divin de la vie étatique et du politique, et celui suscité par la découverte de l’inanité ou de l’impraticabilité des projets émancipateurs.
Max Weber, surtout, va être profondément marqué par la Première Guerre mondiale. L’homme qui voyait la politique essentiellement sous l’angle des rapports de force et des procédures formelles (légitimité légale) s’est de plus en plus préoccupé de la signification qu’elle pouvait avoir pour les différentes couches de la société. La bataille qu’il va mener pour la parlementarisation du Reich se trouvait, certes, déjà en germe dans la période antérieure, mais son soubassement théorique a été quelque peu modifié. L’État-nation n’était plus seulement une machine ou une entreprise, mais un ensemble institutionnel dans lequel les gouvernés devaient pouvoir se reconnaître. Weber était ainsi conduit à rompre avec la conception de l’État identifié à un instrument au service de la nation comme sorte d’essence transhistorique. En fait, il s’éloignait de plus en plus d’une tradition allemande qui, dans la nation, voyait avant tout un peuple, une langue, une culture, et non un ensemble complexe et articulé de relations sociales et politiques, de relations à un passé et à un présent, ensemble dans lequel les institutions et la culture politique devaient forcément jouer un rôle important (cf. Helmut Plessner, Die Verspätete Nation, 1974). La parlementarisation qu’il préconisait ne se réduisait donc pas au choix d’un mode plus efficace de sélection des élites politiques, elle avait un objectif beaucoup plus ambitieux: mettre au point des modes d’association entre hommes politiques, dirigeants et militants des groupements politiques et grande masse des citoyens. Les textes consacrés à la Révolution russe de février 1917 allaient d’ailleurs dans le même sens, puisqu’ils analysaient les faiblesses du libéralisme russe comme résultant de son incapacité à s’implanter dans des réseaux d’institutions locales, régionales et nationales.
On peut faire des remarques analogues à propos des vues de Weber sur la nation dans son cadre international. Elle restait pour lui une valeur fondamentale surtout dans un contexte marqué par une guerre mondiale. Il se devait, par conséquent, de défendre la nation allemande et son droit à l’existence; il se sentait aussi obligé de défendre son droit à s’affirmer dans le concert des grandes nations et tenu de faire valoir le caractère unique de sa culture. Pour autant, il ne se sentait pas lié par les objectifs de guerre proclamés par les dirigeants du Reich et il ne craignait pas de critiquer leur conduite de la guerre. Il n’acceptait ni des objectifs de guerre démesurés (conquêtes territoriales à l’est et à l’ouest), ni des comportements délibérément agressifs et provocateurs dans la conduite des opérations (la guerre sous-marine illimitée, c’est-à-dire étendue aux navires des pays neutres). Dans des textes divers, il a essayé de montrer qu’il fallait avoir une vue très politique de la guerre, débordant des considérations étroitement fixées sur la victoire militaire. Il désirait en particulier que l’Allemagne devienne capable de faire des propositions de paix et cherche en même temps à diviser ses adversaires pour rompre la coalition alliée. Il était en fait partisan d’une conduite modérée de la guerre pour arriver à une paix honorable et durable. De façon implicite, il admettait ainsi que les dispositifs de domination propres à la nation devaient être soumis à une politique de la modération et qu’il fallait s’opposer à un déchaînement incontrôlé de la violence dans les relations entre États. On a vu apparaître de façon significative une préoccupation du même ordre lors des secousses révolutionnaires entre 1918-1920: il a protesté contre les assassinats politiques (Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Kurt Eisner…) et contre les politiques d’exception. Dans ce contexte particulièrement trouble, il s’est clairement montré favorable à la «démocratisation» de la société allemande, mais il voyait cette démocratisation sous des signes aporétiques. Elle devait être conciliée avec de fortes tendances à la bureaucratisation (dans le privé comme dans le public), avec un poids majoré des grands partis de masse dans la vie étatique et avec la cartellisation de l’économie. Elle ne pouvait donc être mise en œuvre que grâce à la préservation de la concurrence en politique comme en économie, c’est-à-dire en excluant des socialisations trop massives dans la grande industrie. Weber estimait inévitable une véritable promotion politique et sociale de la classe ouvrière organisée, mais cela devait se faire dans le cadre de compromis avec la bourgeoisie (cf. E. Baumgarten, Max Weber, 1964, p. 529-533).
On serait porté à dire que Weber a anticipé, dans sa réflexion sur la démocratisation, les développements du Welfare State. Il faut pourtant se garder d’aller trop vite en besogne dans la mesure où son élaboration est restée fragmentaire, souvent allusive. Les derniers mois de la vie de Weber sont marqués par le découragement, le doute et de fortes tensions intérieures. Il a saisi, au moins partiellement, les limites des pouvoirs organisés en système de domination, mais il n’arrivait pas à imaginer ou à se représenter le pouvoir comme capacité de mobilisation collective, comme coopération dans l’action et libération d’énergies multiples. Il restait en réalité l’homme du «subjectivisme poïétique» et il ne concevait toujours la liberté que comme Selbstbehauptung (auto-affirmation) sans se demander explicitement si elle ne pouvait pas être aussi liberté des échanges avec les autres. Sans doute, sa propre maladie, le féminisme de sa femme Marianne, sa liaison avec Elsa Jaffé lui avaient-ils permis de remettre en question bien des vues traditionnelles sur l’individualité, il n’abandonnait pas pour autant l’idée de la Selbstbehauptung : elle devenait simplement plus complexe et plus aléatoire.
Le dernier Weber a vécu au milieu des interrogations, des déceptions politiques et des inquiétudes théoriques. À ses proches, il n’a pas caché qu’il était tenté par la renonciation à la politique et à l’action, et qu’il était très désireux de se consacrer entièrement au travail théorique. Cela n’avait cependant rien à voir avec la volonté de se retirer dans une tour d’ivoire. Il n’y avait pas chez lui d’abandon et de résignation à l’inévitable. Développer la théorie sociologique et politique, c’était dans son esprit se donner de nouvelles possibilités d’intervention pour un avenir plus ou moins proche.
À ce niveau, les apories ne manquaient pas non plus: le formalisme wertfrei, c’est-à-dire neutre axiologiquement de Weber qui n’entendait obéir en sciences sociales qu’à une rationalité formelle, relevait en réalité d’une rationalité matérielle (Materiale Rationalität) occultée, donc non neutralisée, mais fondatrice du formalisme lui-même. Le constructivisme wébérien s’appuyait sur un modèle de l’agir bâti à partir de l’action rationnelle en finalité, présumée être le mode d’agir le plus important et le plus significatif (par opposition aux actions liées aux affects, aux émotions ou à la tradition). La sociologie comme discipline cherchant à être rigoureuse dans ses «idéaltypes» et dans ses schémas
d’interprétation, se trouvait ainsi dépendre de présupposés non thématisés aux conséquences épistémologiques non négligeables. Il y avait d’abord le présupposé de l’individualisme méthodologique dans la schématisation de l’agir, sans doute partiellement justifié contre les hypostases du collectif, mais qui laissait de côté le problème de la présence du social dans l’individuel (présence du langage, de la culture, des institutions et des rapports sociaux eux-mêmes), ou encore le problème de la complexité des interactions et des relations interindividuelles. Il y avait également
le présupposé de la domination comme forme indépassable et incontournable de relation au social et au politique, ce qui excluait a priori de la mettre en perspective et de la traiter comme une réalité sociale-historique en empêchant également d’examiner ses effets sur la culture, les mœurs et les modes de pensée. La sociologie wébérienne, si riche par son imagination créatrice (cf. La Sociologie de la religion) et par la finesse de ses catégorisations (cf. La Sociologie politique et la sociologie du droit) s’est par là donnée à elle-même des obstacles épistémologiques difficiles à franchir. Si l’on veut par conséquent prolonger les questions que Weber a posées à la sociologie et à son époque, il faut essayer d’aller au-delà de ces limites et lui poser des questions qu’il n’a pas lui-même formulées.
Pour aller dans cette direction, il faut naturellement qu’il y ait une meilleure réception de l’œuvre wébérienne. De ce point de vue, il faut se féliciter de la parution progressive, depuis les années quatre-vingt, des œuvres complètes du grand sociologue en allemand. Il faut se féliciter aussi de l’intense discussion qui a eu lieu en Allemagne et à laquelle ont participé des spécialistes anglo-saxons et italiens notamment. En France, la situation est beaucoup moins satisfaisante, même si la connaissance des textes wébériens a beaucoup progressé. On ne possède toujours pas de traduction intégrale d’Économie et Société et la Sociologie de la religion 1 n’est que très partiellement traduite, pour ne prendre que quelques exemples. Il n’est pas exagéré de dire que la plupart de ceux qui veulent travailler sur Weber en France le font à partir de traductions anglaises ou américaines, ce qui, inévitablement, rend plus difficile la compréhension d’une pensée si fortement originale et profondément marquée par le contexte allemand. En d’autres termes, les débats qui ont lieu en France sont menacés par un danger de décontextualisation et d’abstraction. On peut en particulier être tenté de réduire la sociologie wébérienne à une sociologie empirique alors qu’il s’agit certes d’une sociologie à préoccupations empiriques, mais aussi d’une sociologie hautement spéculative, traversée par les grands affrontements théoriques de l’Allemagne de l’époque. Des travaux récents, notamment ceux de Catherine Colliot-Thélène (Max Weber et l’histoire, 1990, Le Désenchantement de l’État, 1992) ont montré l’importance, pour Weber, du rapport critique à l’école historique allemande ainsi qu’aux courants philosophiques posthégéliens (Dilthey représentant la liaison entre historiens et philosophes). La sociologie wébérienne est en large part une sociologie de l’histoire allemande moderne, une sociologie de l’accession tourmentée de l’Allemagne à la modernité, en même temps qu’une sociologie critique des errements des historiens et des métaphysiques sociales.
La sociologie wébérienne ne peut pas non plus être séparée de la grande sociologie, spéculative elle aussi, de son temps. Weber était redevable de beaucoup de choses à Ferdinand Tönnies et à Georg Simmel, ses prédécesseurs en sociologie, ses prédécesseurs aussi dans le débat avec Marx et Nietzsche. Tönnies et Simmel se sentaient assez proches de la social-démocratie (Tönnies y adhère même à la fin de sa vie), mais refusaient aussi bien son millénarisme que la cristallisation dogmatique et orthodoxe de sa culture, c’est-à-dire son marxisme. Ils pouvaient par conséquent entretenir un rapport laïque avec l’œuvre de Marx en essayant de l’utiliser pour faire de la sociologie (et non une critique de l’économie politique). L’analyse par Tönnies des processus de socialisation contemporains devait effectivement beaucoup à l’auteur du Capital. Mais c’est surtout Simmel qui a beaucoup emprunté à Marx dans son livre majeur, La Philosophie de l’argent, ou dans d’autres ouvrages comme Philosophische Kultur. Il y reprenait en effet la thématique du fétichisme de la marchandise et de l’autonomisation des formes sociales à Marx pour en faire des éléments essentiels d’une sociologie de la culture, c’est-à-dire d’une sociologie de la créativité culturelle qui voit se dresser contre elle les objectivations du monde moderne. Selon Simmel, l’esprit humain se trouvait dans la société contemporaine en décalage permanent par rapport à des raffinements matériels de plus en plus grands, ce qui faisait que les formes de vie créées par les hommes risquaient à chaque instant de se pétrifier. La rationalité dans ce cadre pouvait facilement se muer en irrationalité et le vif céder la place à du mort. Weber, qui était assez critique à l’égard de la méthode de Simmel, avait cependant été très impressionné par ces analyses et les conséquences qu’en tirait celui-ci.
#Weber appréciait en particulier le scepticisme de Simmel face aux tentatives intellectuelles pour masquer les difficultés à produire du sens ou les désorientations de la subjectivité. Simmel se méfiait aussi bien des engouements «socialistes» d’une partie de l’intelligentsia allemande que des enthousiasmes irréfléchis pour le progrès technique ou les processus technologiques (la démultiplication des moyens mis à la disposition des hommes). Il critiquait également l’aristocratie frelatée de ceux qui se réclamaient de Nietzsche pour justifier leurs privilèges sans accepter l’ascétisme nietzschéen et sa volonté de lucidité (voir à ce sujet Georg Simmel, Schopenhauer und Nietzsche, 1990). Pour Weber, Simmel présentait l’avantage d’être, dans l’économie des échanges intellectuels allemands, un critique bourgeois du socialisme et de la bourgeoisie. Sans doute les positions de Simmel étaient-elles ambivalentes, tentées notamment par l’anticapitalisme, mais elles montraient la possibilité de ne pas se conformer aux «habitus» et aux humeurs bourgeois dominants sans tomber pour autant dans une opposition systématique à la culture bourgeoise: comme Simmel, Weber répudiait l’adoption par une partie de la bourgeoisie des mœurs et coutumes de la noblesse prussienne, comme lui il s’opposait à la surestimation dans la société allemande des valeurs militaires.
On peut considérer qu’il y avait également accord entre eux sur certaines orientations stratégiques à suivre dans les sciences sociales. Si la sociologie ne pouvait pas être conçue comme une discipline au service immédiat de l’État, elle devait jouer un rôle essentiel dans les processus de formation de la réalité étatique et politique moderne (ce que Norbert Elias a appelé plus tard, « Staatsbildungsprozess » dans Studien über die Deutschen, 1990). De ce point de vue, il faut penser à la place stratégique qu’a chez Simmel la gestion de la conflictualité sociale et qu’a chez Weber le couple de contraires, domination et démocratisation. Dans la perspective de Simmel et Weber, les sciences sociales devaient s’attaquer aux archaïsmes de la société allemande d’après 1871, mais aussi participer à la modernisation des institutions sans semer des illusions sur une perfectibilité infinie du social. Elles avaient à prendre leurs distances par rapport à l’« économisme» des Gründerjahre (années fondatrices) pour restituer au culturel et au politique (vu comme action stratégique) toute leur importance dans la dynamique sociale. Elles devaient également labourer et subvertir les champs théoriques en rendant peu à peu impossibles certains discours traditionnels sur la société, le discours de la philosophie sociale, les discours d’origine théologique, les discours utilitaristes. Ils ne prétendaient pas que la sociologie devait se substituer à la philosophie, à l’économie, ou dire le dernier mot sur la société, ils entendaient que les conditions d’exercice des disciplines théoriques et empirico-scientifiques ne soient plus les mêmes qu’auparavant. Ils ne se fiaient naturellement pas à la seule force des idées, et c’est pourquoi ils ont fondé en 1909 avec Tönnies la Société allemande de sociologie, premier pas vers une véritable institutionnalisation et point de départ possible pour une offensive en direction des universités et de la communauté universitaire.
Acheter "Max Weber ou la démocratie inachevée"
Le Félin préfère habituellement faire marcher la librairie, mais en ces temps incertains il nous a paru important de pouvoir "dépanner" nos lecteurs en leur proposant ce module de vente en ligne. Il vous suffit d'envoyer un chèque du montant de votre commande aux éditions du Félin (7 rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris), les frais de port sont à notre charge. Merci !
Max Weber est l’un des grands classiques de la sociologie.Mais les hommages en faveur de l’auteur de L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme ne lui rendent pas forcément justice. Sa pensée rugueuse et pleine d’arêtes est trop souvent aplanie et lissée. L’ouvrage de Jean-Marie Vincent, qui est un dialogue critique avec l’oeuvre wébérienne, entend lui restituer toute sa force et sa charge d’inquiétude. L’idéal scientifique de Weber, comme le notait le philosophe Adorno, était polémique. Il ne voulait pas rassurer, mais bousculer les conforts intellectuels, et c’est en ce sens qu’il faut prolonger sa réflexion. Max Weber, dont les relations avec la démocratie étaient ambivalentes, est aussi l’un des penseurs qui permet lemieux de saisir l’inachèvement de cette dernière et la nécessité de la mener plus loin. La crise des « grands récits » – celle, par exemple, du communisme – donne à la pensée de Weber une force et un attrait renouvelés. De fait, la relecture de son oeuvre est aujourd’hui essentielle pour tout projet d’extension et d’approfondissement de la démocratie.
Jean-Marie Vincent (1934-2004). Philosophe et sociologue, il fonde en 1968 et dirige jusqu’en 2002 le département de sciences politiques de l’Université Paris VIII. Il lance les revues Futur antérieur en 1990 puis Multitudes en 2001. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont La théorie critique de l’École de Francfort, Paris, Galilée, 1976 ; Critique du travail, Paris, PUF, 1987 ; Vers un nouvel anticapitalisme (avec Michel Vakaloulis et Pierre Zarka), Paris, Le Félin, 2003.
Préface de Catherine Colliot-Thélène